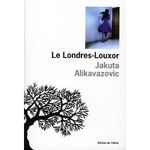"Celui que le destin poursuit ne peut s'en délivrer"*
"La famille de Pascal Duarte" de Camilo José Cela
4 étoiles
Points, 1990, 145 pages, isbn 2020115646
(traduit de l'Espagnol par Jean Viet)
Le tout premier roman publié en 1942 par Camilo José Cela – qui devait par la suite obtenir le prix Nobel de littérature, en 1989 – aurait tout aussi bien pu s'intituler "La confession de Pascal Duarte", une confession au sens religieux du terme car le moins que l'on puisse dire est que ce pauvre paysan issu d'un modeste village d'Estrémadure en a gros sur la conscience. Son habitude de régler le moindre différend à coups de couteau l'a en effet amené à commettre plusieurs meurtres et à épuiser toutes les mesures de clémence que la justice des hommes pouvait lui offrir. Cette fois, c'est bien fini, le séjour en prison qu'il met à profit pour rédiger sa confession sera le dernier, et il ne prendra fin que le jour de son exécution.
Du reste, c'est là une très drôle de confession dont l'auteur semble ne jamais assumer la responsabilité de ses actes, la rejetant sur une obscure fatalité, sur quelque malédiction congénitale ou sur les provocations des uns ou des autres, ainsi de Zacarias, qui "au milieu du tapage, voulut faire le malin, nous racontant je ne sais quelle histoire de tendre ravisseur, dont j'aurais bien juré sur le moment – et maintenant encore – qu'elle était à mon intention; je ne fus jamais susceptible, mais il est des attaques si directes – ou qui semblent telles – qu'on ne peut les souffrir sans sortir de ses gonds et bondir." (p. 69) Principal narrateur du roman, Pascal Duarte n'est donc en aucune façon digne de confiance. Mais la puissance de son discours - à peine recadré par quelques documents brefs que Camilo José Cela attribue à d'autres personnages et qui font office d'introduction et de conclusion à son livre - est telle que bien loin de devoir s'efforcer de "suspendre son incrédulité" (selon la belle expression d'Alberto Manguel), on se trouve embrigadé sans réserve par cette vision fataliste à laquelle nul être raisonnable ne pourrait pourtant adhérer, et que l'on se voit mis en demeure d'effectuer mentalement un pas de côté pour s'en déprendre.
C'était donc un très grand premier roman que celui-là. Un texte âpre, cru et brûlé d'un soleil éblouissant, animé par une mécanique aussi implacable que tragique, et qui s'est imposé non sans raison comme le roman espagnol le plus traduit après "Don Quichotte".
Extrait:
"Moi, monsieur, je ne suis pas méchant et pourtant j'aurais mes raisons pour cela. Nous, mortels, nous avons tous en naissant la même peau, mais, à mesure que nous grandissons, le destin se plaît à nous diversifier, comme si nous étions de cire, et à nous mener par des sentiers multiples vers une seule fin: la mort. Il y a des hommes qui doivent prendre le chemin des fleurs, pendant que d'autres sont poussés à travers chardons et nopals. Les uns possèdent un regard tranquille et, au parfum de leur bonheur, ils sourient d'un visage innocent; les autres, accablés du soleil violent de la plaine, se hérissent comme la vermine pour se défendre. D'un côté, pour embellir son corps, le fard et les parfums; de l'autre, les tatouages que nul ensuite n'est capable d'effacer...
Je suis né voilà bien des années – cinquante-cinq pour le moins – dans un village perdu de la province de Badajoz. Il était accroupi à quelques deux lieues d'Almendralejo, sur une route monotone et longue comme un jour sans pain, monotone et longue comme les jours – dont, pour votre bien, vous ne pouvez même imaginer la longueur ni la monotonie – d'un condamné à mort...
C'était un village chaud et ensoleillé, assez riche d'oliviers et de cochons (sauf votre respect), avec des maisons si blanches que le souvenir m'en blesse encore les yeux, une place toute pavée et une belle fontaine à trois jets au milieu de la place." (pp. 17-18)
*"(...) celui que le destin poursuit ne peut s'en délivrer, même en se cachant sous les pierres." (p. 45)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)