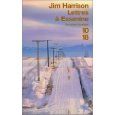Autoportrait de l’artiste en jeune mouton
"Pelures d’oignon" de Günter Grass 
4 étoiles
Seuil/Points, 2007, 476 pages, isbn 9782757810149
(traduit de l’Allemand par Claude Porcell)
De Günter Grass, auteur des mois de décembre 2008 et janvier 2009 sur Lecture/Ecriture, j'avais tout d'abord découvert - et beaucoup aimé - "Toute une histoire". Je l'avais ensuite retrouvé avec "Le tambour", difficile, aride, mais impressionnant et sans aucun doute un incontournable de la littérature du XXème siècle. Enfin, j'ai renoncé à venir à bout de son "Turbot", à mon sens totalement illisible... "Pelures d'oignon" représente donc pour moi un quatrième rendez-vous avec cet auteur allemand originaire de Dantzig, et ce fut un rendez-vous passionnant...
Depuis que le prix Nobel de littérature lui avait été attribué en 1999, Günter Grass avait acquis – définitivement, à ce qu’il semblait alors – la réputation d’être un témoin essentiel du XXème siècle, et la conscience d’une certaine Allemagne de l’après-guerre. C’est dire que ces "pelures d’oignon", où Günter Grass retrace ses jeunes années ont fait l’effet d’un fichu pavé dans la mare lors de leur parution en 2006. On y découvre en effet un tout jeune Günter Grass, enrôlé, irréprochable sinon particulièrement zélé, dans les jeunesses hitlériennes, puis dans la défense passive et enfin – volontairement – chez les Waffen SS qu’il a rejoint tout à la fin de la guerre, juste à temps pour prendre part à la débacle finale sur le front de l’Est. "Croyant jusqu’à la fin. Pas vraiment fanatique, mais le regard immuablement fixé par réflexe, sur le drapeau dont on disait qu’il était « plus que la mort », je restais au garde-à-vous et j’étais exercé à marcher au pas. Aucun doute ne venait blesser cette foi, rien de subversif, comme par exemple la distribution de tracts, ne peut me décharger. Aucune blague sur Goering ne me rendait suspect. Je voyais bien plutôt la patrie menacée, encerclée d’ennemis." (pp. 45-46)
Pour paraphraser Dylan Thomas et son "portrait de l’artiste en jeune chien", c’est son autoportrait en jeune mouton, qui suit le reste du troupeau sans se poser de questions, que Günter Grass dresse ici, sans aucune indulgence car les occasions de se poser des questions, justement, ne manquaient pas. Mais il entoure si bien son récit de précautions oratoires, nous rappelle si souvent les pièges et les incertitudes de souvenirs si lointains, et pour beaucoup, soigneusement occultés, que je ne sais finalement que penser de ces "pelures" et des confessions qu’elles recèlent: s’agit-il ici, oui ou non, d’un repentir sincère ou plutôt d’une ultime forme de coquetterie, sur le mode du "vous voyez bien que je ne cherche pas à me montrer sous un jour avantageux"?
Mais quel que soit l’agenda secret de l’auteur, "Pelures d’oignon" est un livre passionnant. Parce qu’il éclaire de nombreux autres ouvrages de Günter Grass, tout en évoquant sous leur véritable identité les modèles de quelques uns de ses personnages les plus marquants. Parce qu’il nous apporte un témoignage rare, et donc important même s’il vaut peut-être mieux le prendre avec des pincettes, de l’Allemagne nazie vue de l’intérieur, par l’un des bons sujets du Führer et non par l’un de ses opposants… Et parce qu’il nous livre un récit hallucinant de la débacle de l’armée allemande dans les dernières semaines de la guerre.
Extrait:
"Le souvenir aime le cache-cache des enfants. Il se planque. Il a un penchant pour les belles paroles et il enjolive, souvent sans nécessité. Il contredit la mémoire, qui fait la vétilleuse et se chamaille pour avoir raison.
Quand on le presse de questions, le souvenir ressemble à un oignon qui voudrait être pelé afin que soit dégagé ce qui, lettre après lettre, est là, lisible: rarement univoque, souvent dans une écriture à lire dans le miroir ou crypté d’une quelconque manière.
Sous la première peau, qui produit encore un crissement sec, se trouve la suivante, laquelle, à peine détachée, en libère une autre, humide, sous laquelle attendent et chuchotent la quatrième, la cinquième. Et chacune de celles qui viennent sur des mots trop longtemps évités, des signes tarabiscotés aussi, comme si quelque faiseur de mystères avait voulu depuis sa jeunesse, à l’époque où l’oignon ne faisait encore que germer, s’envelopper d’un chiffre." (p. 11)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)