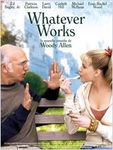Faste méditatif
"Les splendeurs de Versailles",
par le Choeur de chambre de Namur et Les Agrémens,
sous la direction de Guy Van Waas
Théâtre Royal de Namur, le 26 février 2010
Rassemblant sous le titre des "Splendeurs de Versailles" des oeuvres de deux des principaux compositeurs au service du roi Louis XIV, Jean-Baptiste Lully et Henri Du Mont, Guy Van Waas et les interprètes du Choeur de chambre de Namur et des Agrémens nous ont offert ce vendredi soir un concert dont le faste méditatif était bien éloigné des sonorités étincelantes du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier ou des airs de danse des grandes comédies-ballets de Molière.
Dès l'entrée, le Dies Irae composé par Jean-Baptiste Lully pour les funérailles de la reine Marie-Thérèse a en effet imposé une atmosphère de recueillement que les deux motets d'Henri Du Mont qui suivaient - Nisi dominus et Magnificat - ne sont pas venus démentir. Pas plus d'ailleurs que la seconde partie du concert, l'Idylle sur la Paix, célébration de la paix retrouvée et de la gloire du Prince composée par Jean-Baptiste Lully sur un livret de Jean Racine - véritable monument non du génie dramatique qui a fait passer l'auteur de Phèdre à la postérité mais bien de pure et simple flagornerie - où les prières pour la prospérité et la santé du roi se mêlaient toujours aux expressions de joie. Du reste, l'on ne s'en plaindra pas car ces musiques déployaient des couleurs véritablement fastueuses, et en d'autres mots ces splendeurs versaillaises certes empreintes de recueillement n'en étaient pas moins magnifiques.
Présentation du concert sur le site du Théâtre Royal de Namur


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)